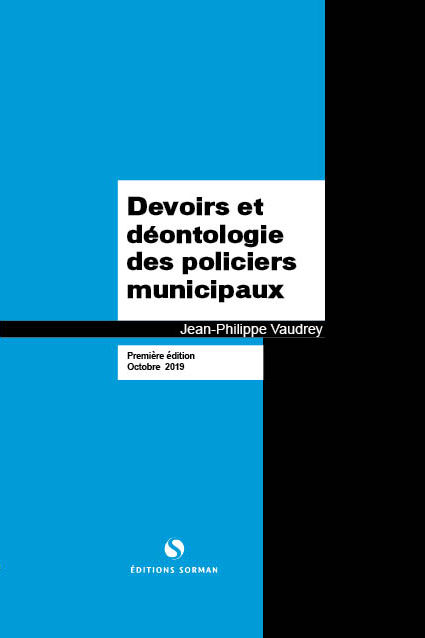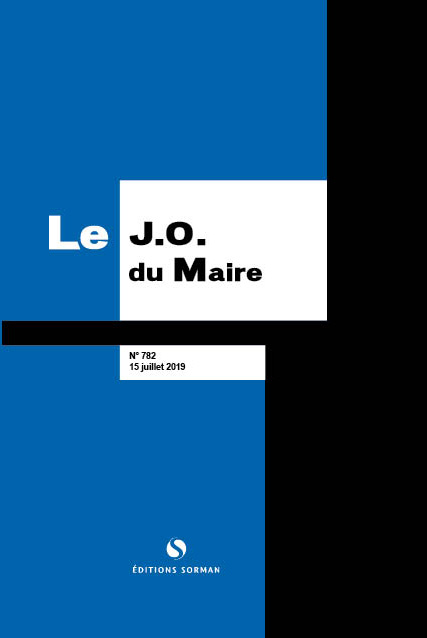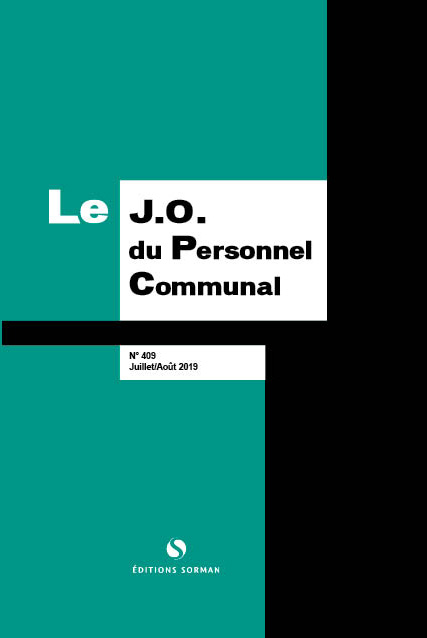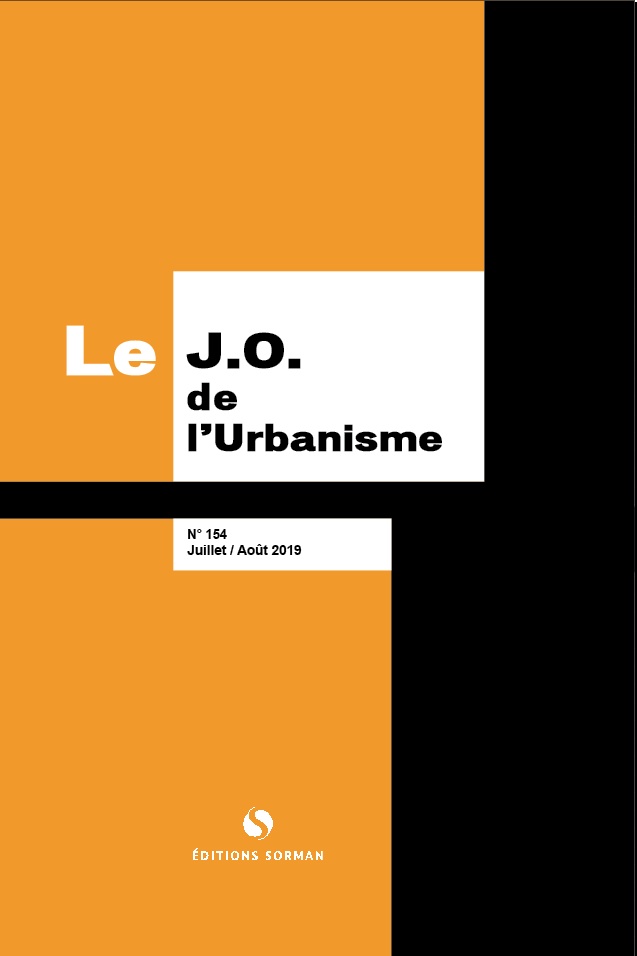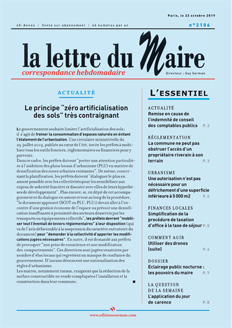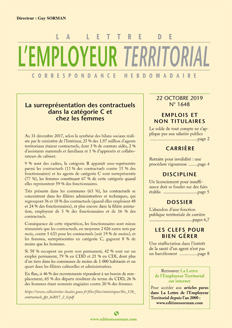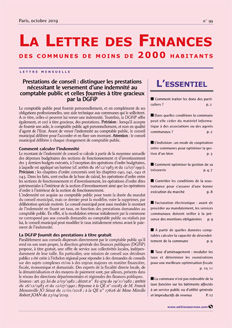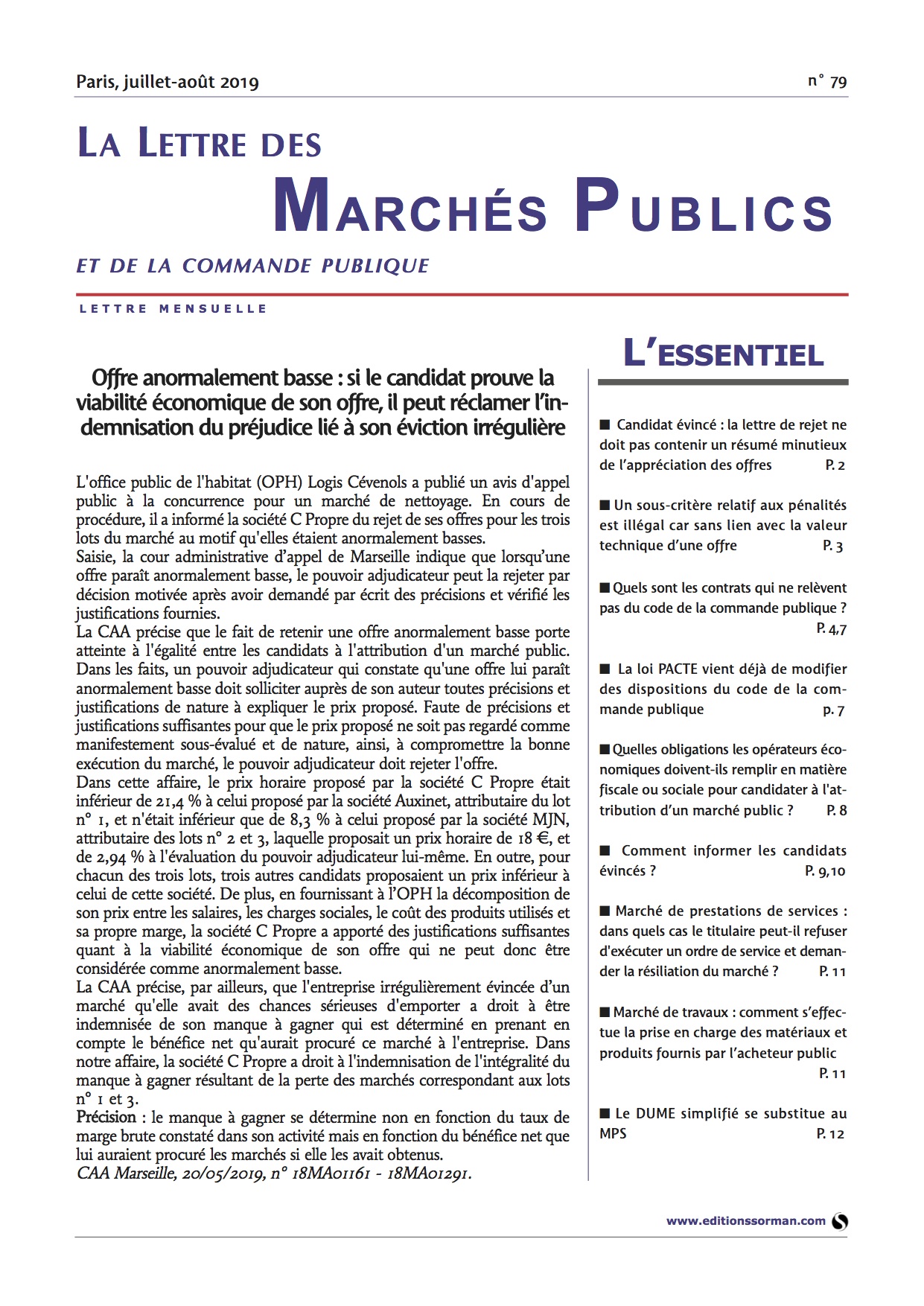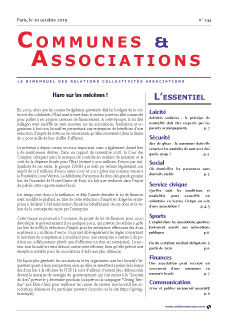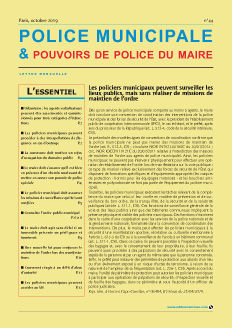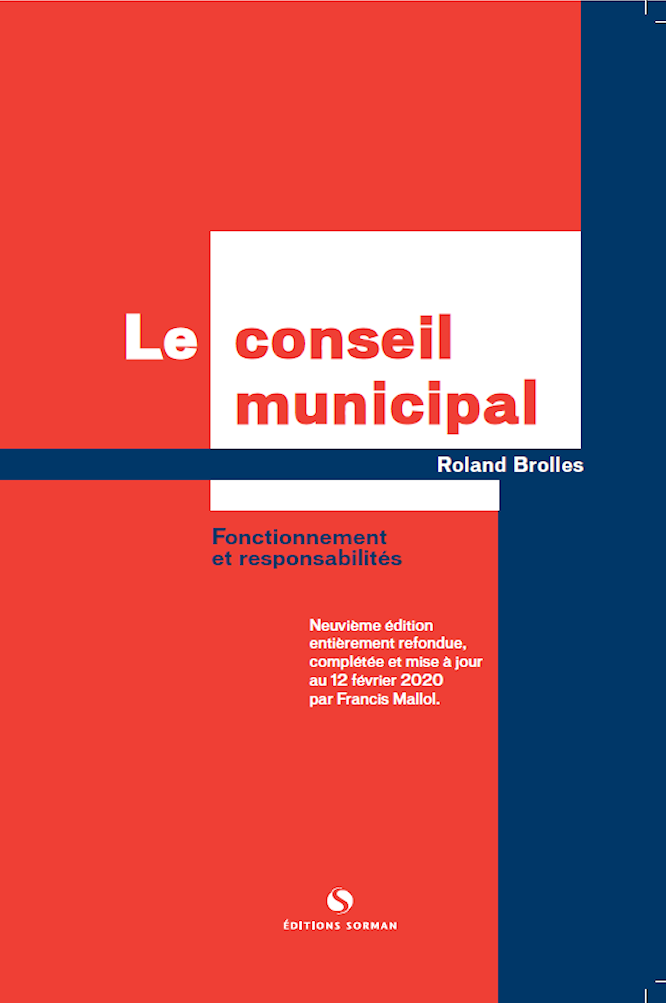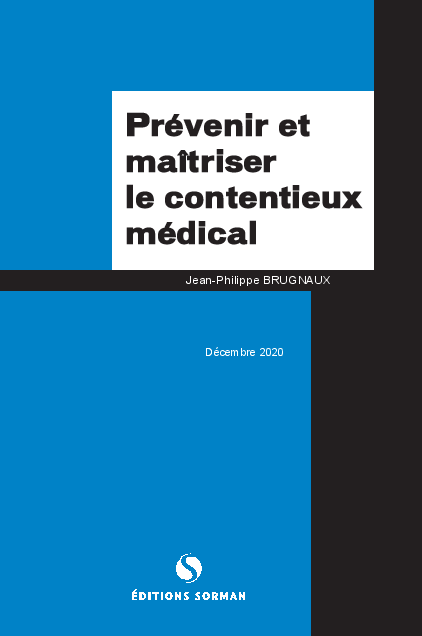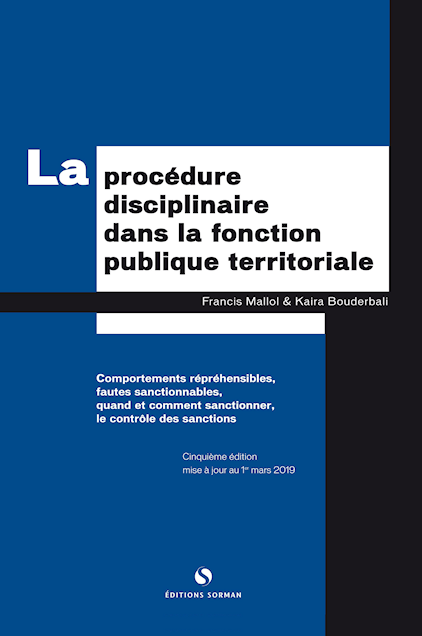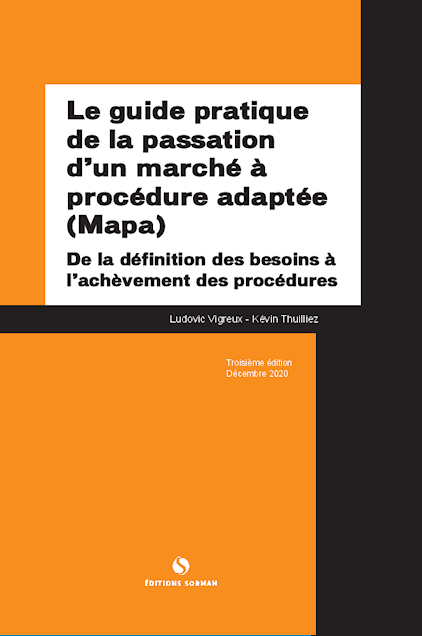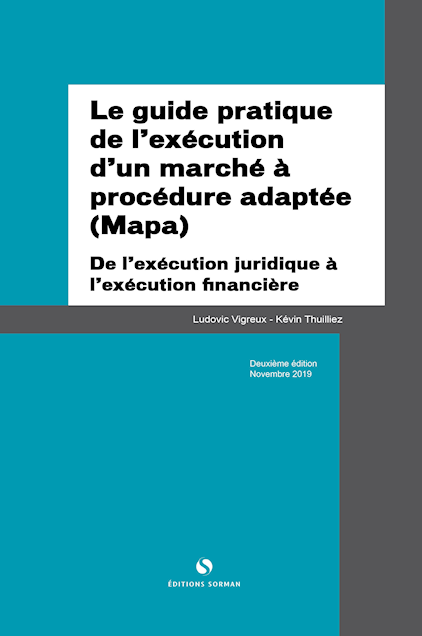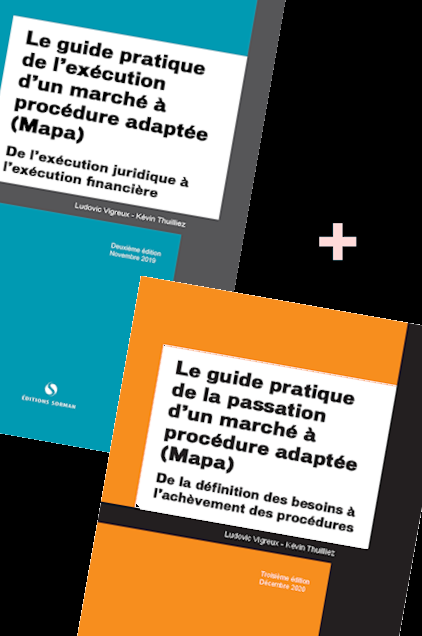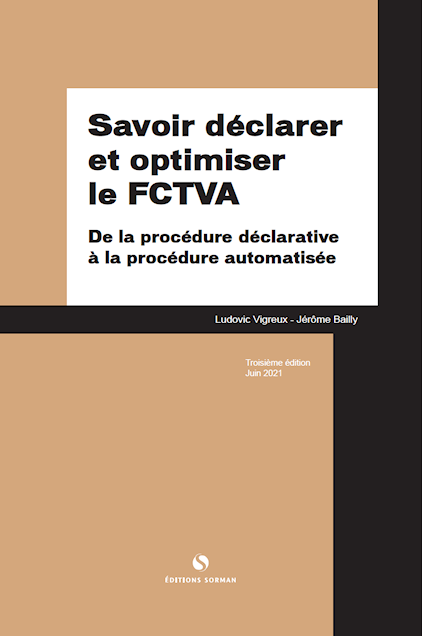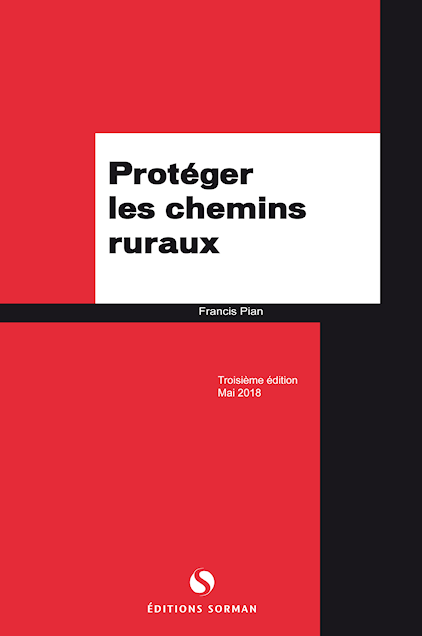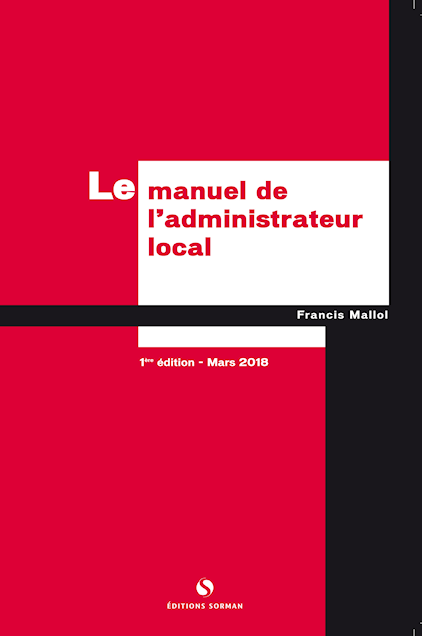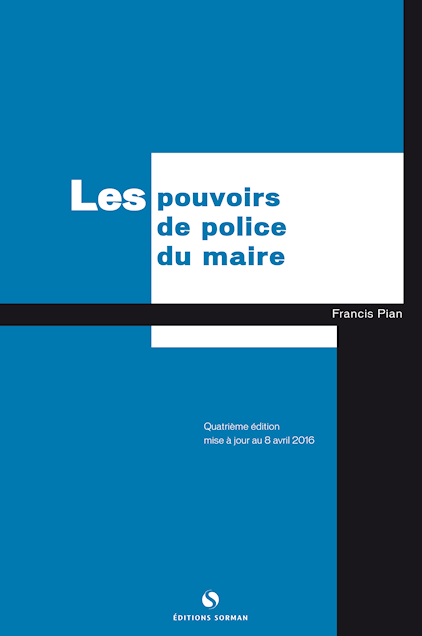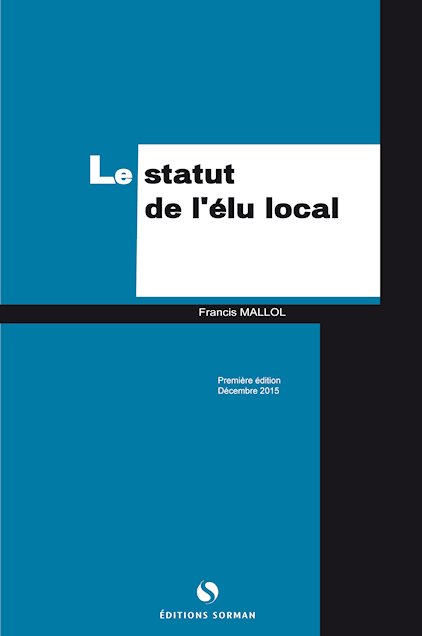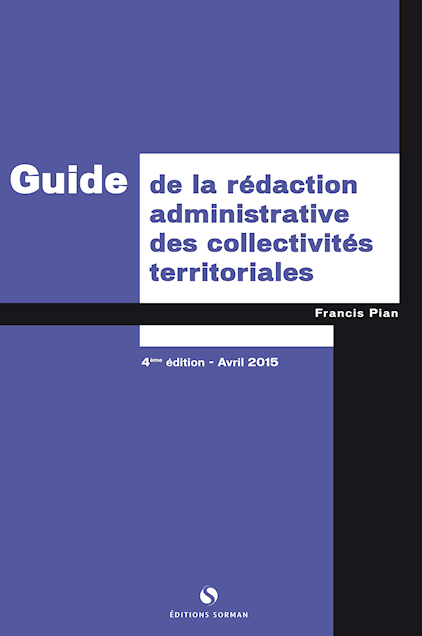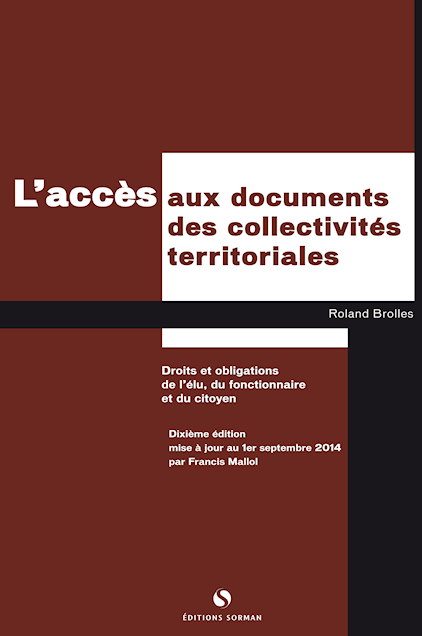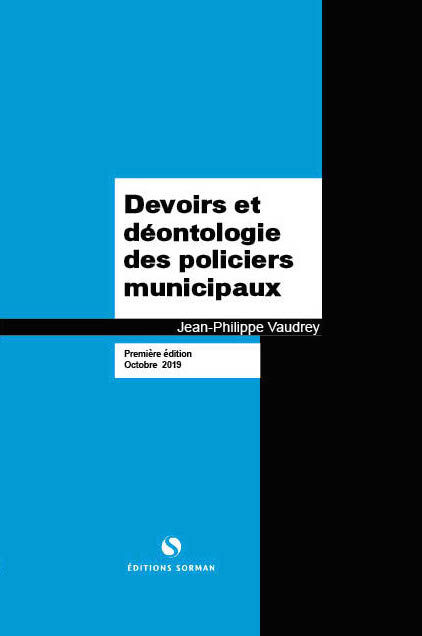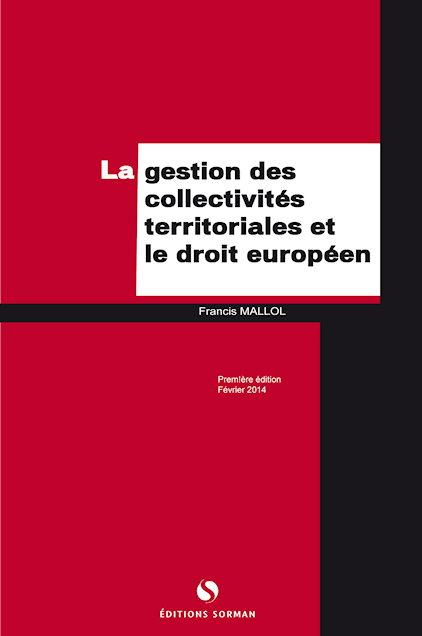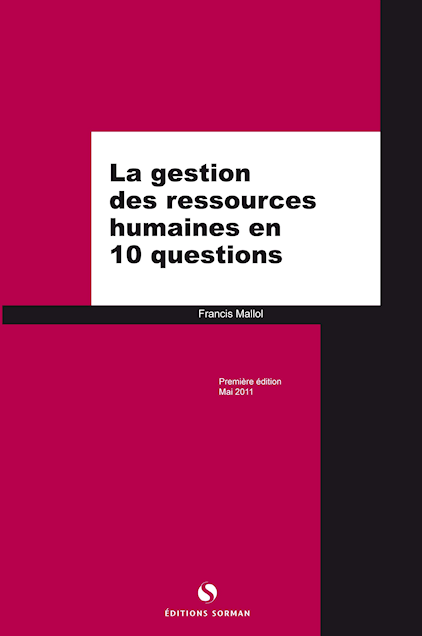Révocation : quelles conséquences tirer des décisions juridictionnelles successives ?
Le conseil départemental révoque, le 15 mai 2017, un adjoint administratif de 2e classe après la découverte de deux condamnations en 2008 et 2012 ne figurant pas au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, la première ayant été effacée et la seconde non inscrite.
En référé, le 13 juillet 2017, le tribunal administratif suspend l’exécution de l’arrêté. Le président du conseil départemental réintègre alors l’agent à titre provisoire le 8 septembre, avant que le tribunal n’annule la révocation le 22 janvier 2018, estimant que la matérialité des faits n’était pas établie.
Il enjoint au département de réintégrer l’agent et de reconstituer sa carrière au 15 mai 2017.
La cour annule la décision du tribunal le 4 décembre 2019 et, à son tour, le président du département « retire », le 19 janvier 2021, l’arrêté du 8 septembre 2017 réintégrant l’adjoint administratif.
Ce dernier sollicite et obtient de nouveau du tribunal la suspension de cet arrêté le 25 mars 2021, le juge estimant que l’arrêté du 19 janvier 2021 revenant sur sa réintégration a méconnu le délai de retrait de 4 mois dont disposait le département après la décision de la cour de décembre 2019 confirmant la révocation.
Le tribunal statuant en dernier ressort, le conseil départemental saisit le Conseil d’État en cassation (article L. 523–1 du code de justice administrative).
La condition d’urgence satisfaite
En cas de suspension, le juge statue sur la requête en annulation dans les meilleurs délais et elle prend fin au plus tard avec la décision (article L. 521–1 du code de justice administrative).
La condition d’urgence implique que la décision porte un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation de l’agent ou aux intérêts qu’il défend. Il importe peu que la décision ait un objet ou des répercussions purement financières et qu’en cas d’annulation ses effets puissent être effacés par une réparation pécuniaire. Le juge apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de la décision sur sa situation (ou des personnes concernées) sont de nature à caractériser une urgence justifiant une suspension, sans attendre un jugement au fond (CE n° 228815 confédération nationale des radios libres du 19 janvier 2001).
En cas d’éviction privative de rémunération, pour apprécier si la décision porte préjudice de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, il n’y a pas lieu pour l’agent de fournir des précisions sur les ressources et les charges de son foyer à l’appui de sa demande (CE n° 325638 Mme B du 24 juillet 2009).
Le tribunal puis le Conseil d’État relèvent que la révocation prive le fonctionnaire de toute rémunération. Avec des charges mensuelles incompressibles de 900 €, alors que sa compagne n’a pas de revenus, et un enfant à charge né le 12 février 2019, et que s’il avait perçu des allocations chômage pour le mois de février 2021 elles auraient été d’un faible montant, la condition d’urgence apparaît remplie. Il importe peu que la femme ait sollicité une disponibilité après son congé parental.
Une jurisprudence évolutive
Si, pour le tribunal, un retrait de la réintégration n’était possible que dans les 4 mois suivant la décision de la cour annulant la révocation, pour le département, la réintégration était provisoire et un retrait possible tant que le juge n’avait pas statué définitivement.
Si l’arrêt prive de base juridique la réintégration liée à l’exécution du jugement du tribunal, elle demeure dans l’ordonnancement juridique tant que l’employeur ne l’a pas retirée ou abrogée, même si elle est créatrice de droits.
Toute la question est donc de savoir dans quelle mesure il est possible de retirer ou abroger la décision consécutive au jugement du tribunal.
Le Conseil d’État a d’abord refusé tous « droits acquis » à l’encontre d’une mesure intervenue pour exécuter un jugement d’annulation dont le sens n’est pas confirmé par la juridiction supérieure. Si elle inverse la solution initiale, l’administration doit retirer toutes les mesures d’exécution, comme une réintégration après l’annulation d’une révocation, ensuite confirmée par le Conseil d’État (CE n° 65193 M. M du 21 janvier 1966).
Avec la jurisprudence qui laisse à l’administration 4 mois pour retirer une décision explicite créatrice de droits si elle est illégale, sauf texte ou demande du bénéficiaire (CE Ass. n° 197018 M. X du 26 octobre 2001, codifiée à l’article L. 242–1 du code des relations entre le public et l’administration), le juge a inversé sa position. En cas d’annulation par une décision juridictionnelle supérieure, l’administration a 4 mois pour retirer sa mesure d’exécution, sans y être obligée, mais peut l’abroger à tout moment (CE n° 384144 ministre des Finances du 19 décembre 2014).
Mais le retrait doit intervenir dans un délai raisonnable, de 4 mois à compter de la notification du rejet de la demande d’annulation. Les décisions créatrices de droit postérieures à cette date ne sont plus provisoires et ne peuvent être retirées que pour illégalité dans les 4 mois de leur signature (CE n° 416313 ministre d’État, ministre de l’Intérieur du 23 mai 2018).
Le maintien de la ligne jurisprudentielle
La rapporteure publique suggère de maintenir cette ligne jurisprudentielle, la seule différence de l’affaire tenant à la succession d’une suspension confirmée par le tribunal, suivie d’une annulation par la cour.
Reste que le département n’a pas tiré des conséquences de l’annulation de la révocation par le tribunal par un arrêté se substituant à celui du 8 septembre 2017 réintégrant l’adjoint dans le cadre de la suspension. Il maintient que la réintégration n’était pas créatrice de droits, ignorant le jugement d’annulation qui a fait perdre à la réintégration son caractère provisoire, et l’injonction du tribunal de réintégrer l’agent et de reconstituer sa carrière.
Qu’on la regarde comme provisoire ou consécutive à l’exécution du jugement du tribunal, la réintégration était créatrice de droits pour l’agent et ne pouvait pas être retirée au-delà des 4 mois suivant la notification de la décision de la cour.
Le recours en cassation ajoute encore de la complexité à une situation mêlant procédures de référé, jugements au fond et voies de recours.
Le département aurait dû prendre un premier arrêté de réintégration à titre provisoire avec l’ordonnance de suspension, 6 mois plus tard un 2e arrêté de réintégration après le jugement d’annulation, un 3e arrêté retirant l’arrêté de réintégration après son annulation par la cour, voire un 4e en vue d’une réintégration après le recours en cassation du département.
Sans contraindre l’employeur à s’abstenir d’exécuter un arrêt lui permettant de revenir sur une décision de réintégration qu’il n’a pas souhaitée (et se trouve sans base légale), la rapporteure suggère, lorsqu’il obtient satisfaction en appel mais que l’agent s’est pourvu en cassation, d’attendre une décision irrévocable sur la légalité de la révocation, pour en tirer toutes conséquences, l’employeur disposant d’une possibilité de retrait différé à l’issue finale du procès.
Son renoncement à exécuter une décision de justice ne serait que temporaire et facultatif, lui permettant de choisir entre l’exécution de la décision dont il bénéficie et l’attente de l’issue du contentieux. Du point de vue de l’agent, son recours reste utile et il bénéficie d’un sursis dans l’exécution de la décision juridictionnelle qu’il conteste.
Le maintien d’un retrait sous 4 mois
Le Conseil d’État estime à son tour qu’en cas d'annulation, par le juge d'appel, du jugement ayant annulé la révocation d'un agent public (si les motifs de la décision ne s’opposent pas à une nouvelle révocation), l'employeur ne peut retirer la réintégration prise en exécution du premier jugement que dans un délai raisonnable de 4 mois à compter de la notification de la décision rendue en appel.
Passé ce délai, et si un pourvoi en cassation a été introduit contre l'arrêt confirmant la révocation, il a de nouveau la faculté de retirer la décision de réintégration, dans un délai raisonnable de 4 mois à compter de la réception de la décision rejetant le pourvoi ou de la notification de la décision qui, après la cassation, confirme en appel l'annulation du premier jugement. Dans tous les cas, avant le retrait, il doit inviter l'agent à présenter ses observations.
Sur un plan financier, lorsque la réintégration d’un agent révoqué est prise en exécution d'une décision de justice, l'intéressé a droit à la rémunération correspondant à ses fonctions, sauf absence de service fait résultant de son refus d'effectuer les missions confiées, ou d’une mesure judiciaire s’opposant à toute fonction dans les services de l’employeur. Les sommes ainsi perçues ne peuvent pas faire l'objet d'un reversement à l’employeur.
Dans l’affaire, le département ayant retiré la réintégration au-delà des 4 mois suivant la décision de la cour, le juge des référés pouvait bien estimer qu’un doute sérieux pesait sur sa légalité.
CE n° 451500 département de la Seine-Saint-Denis, 9 décembre 2022.
Pierre-Yves Blanchard le 27 juin 2023 - n°1819 de La Lettre de l'Employeur Territorial
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline