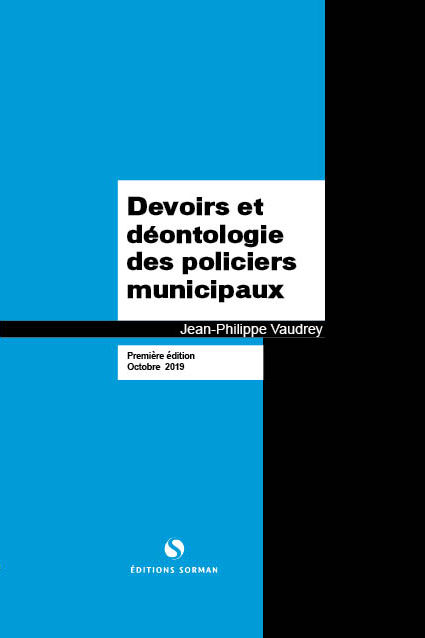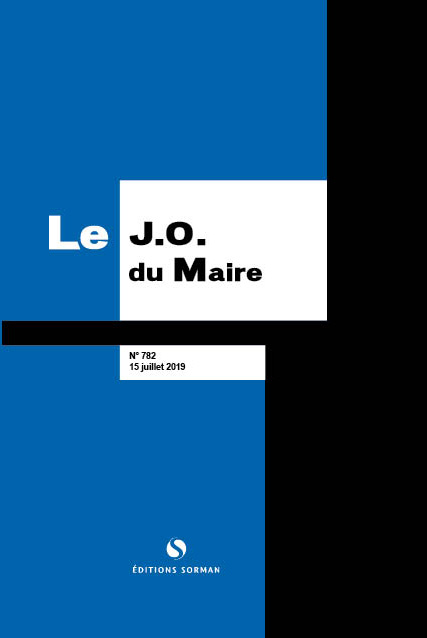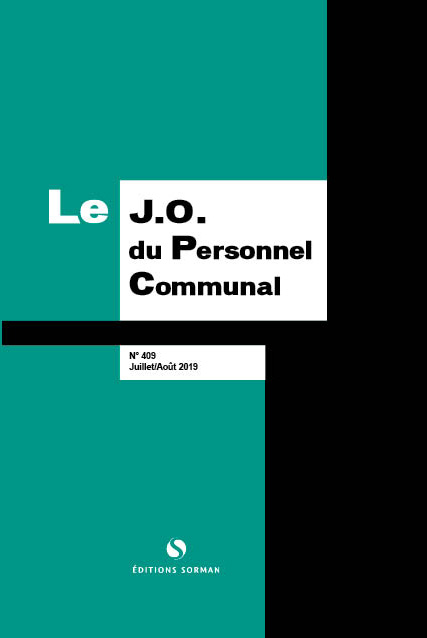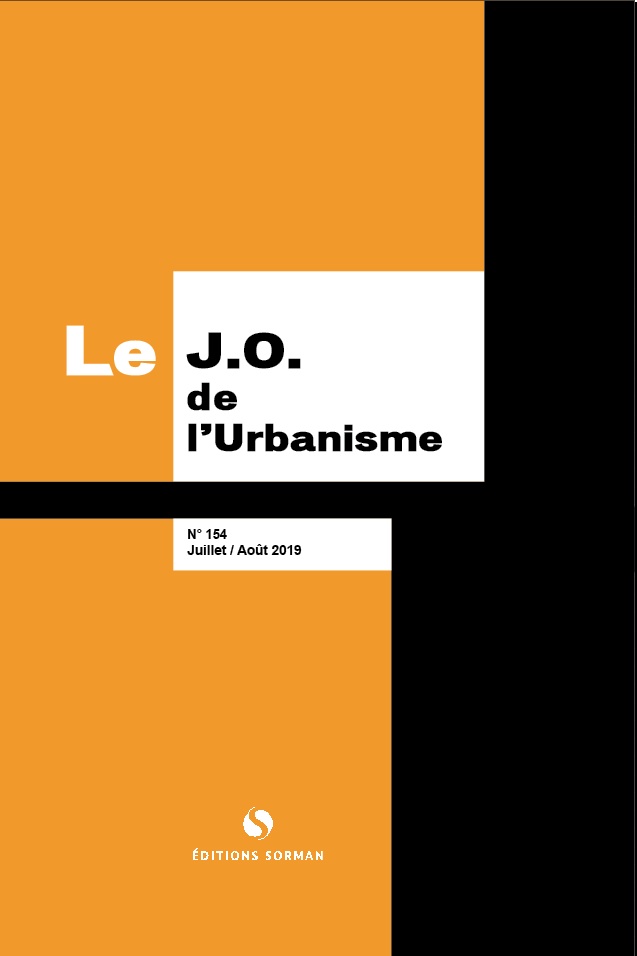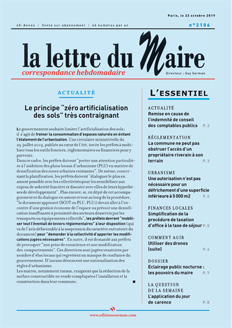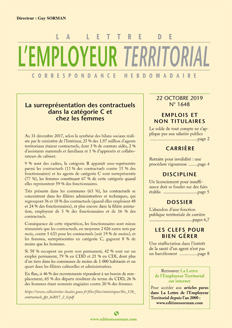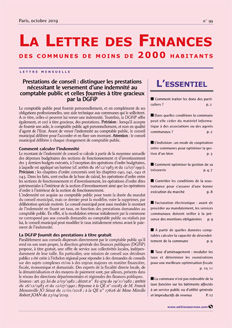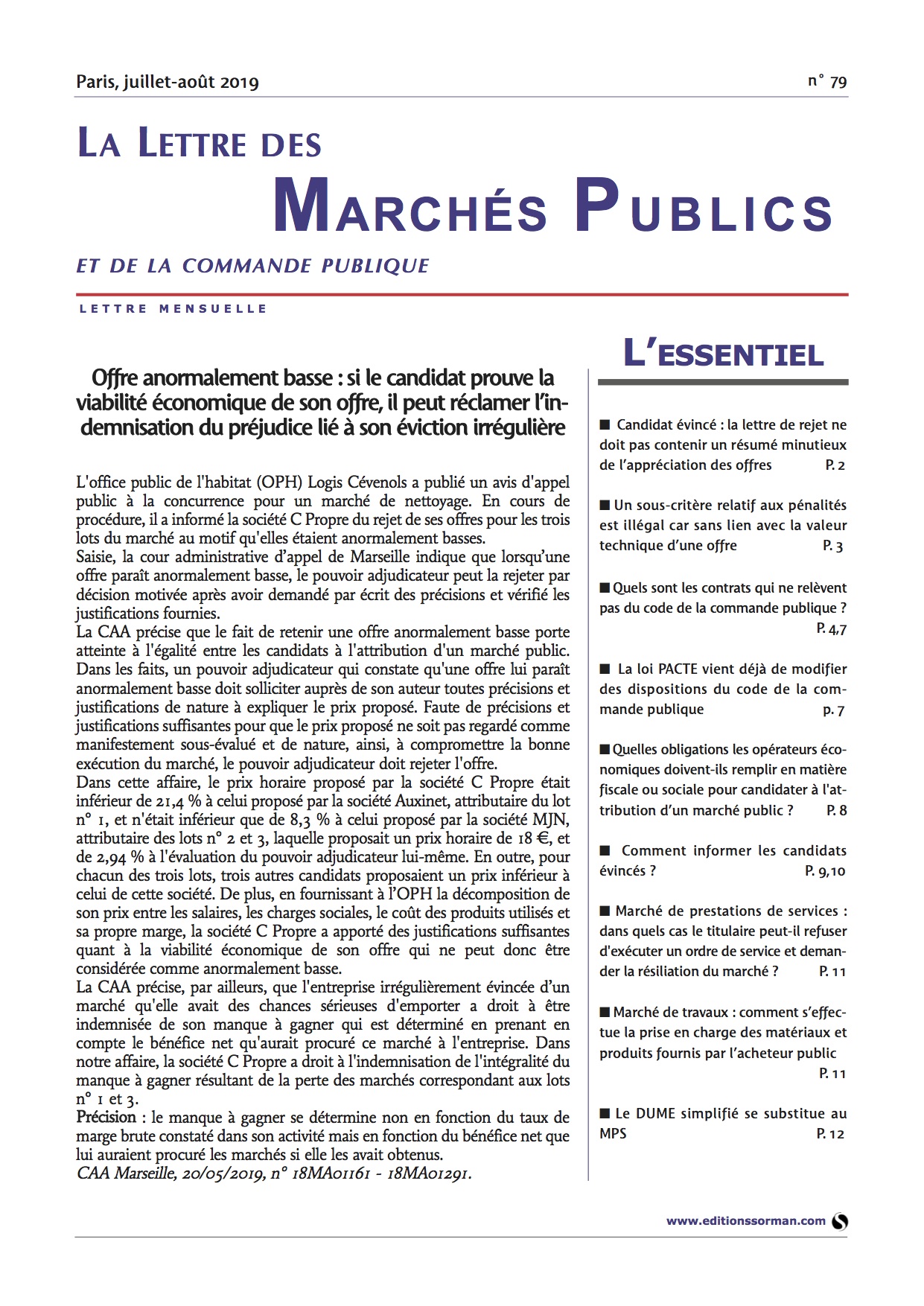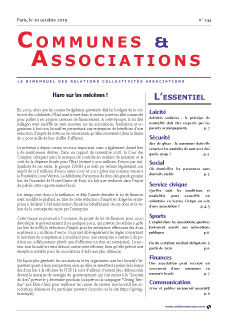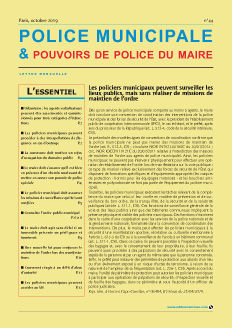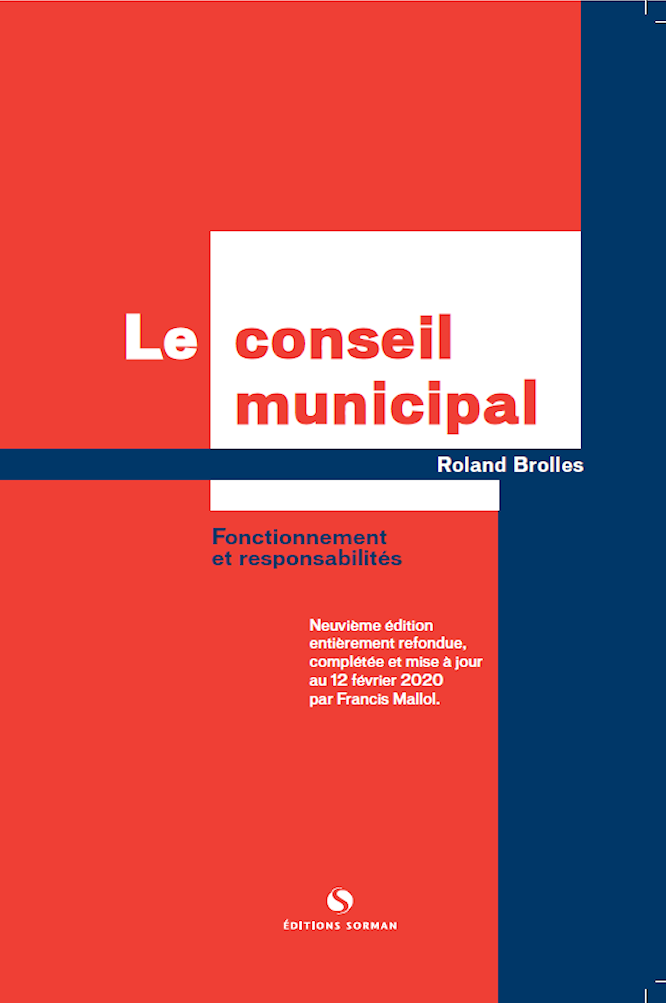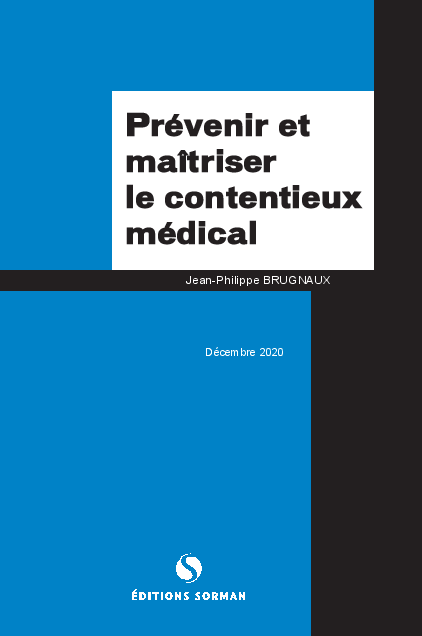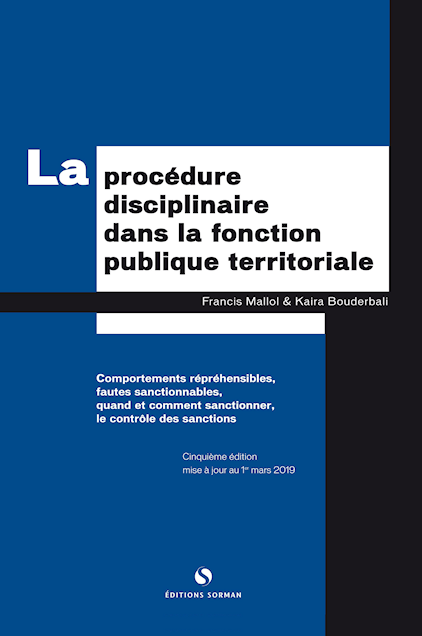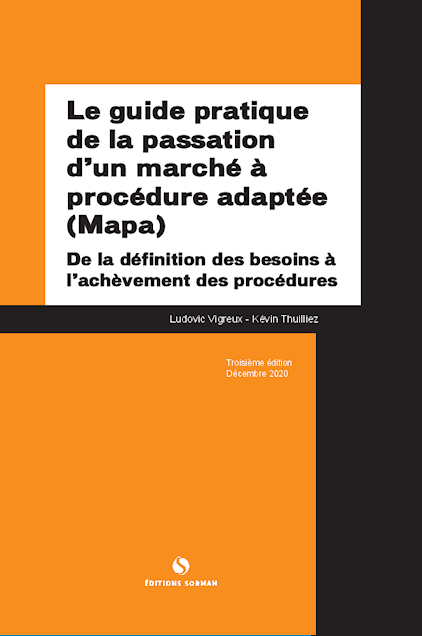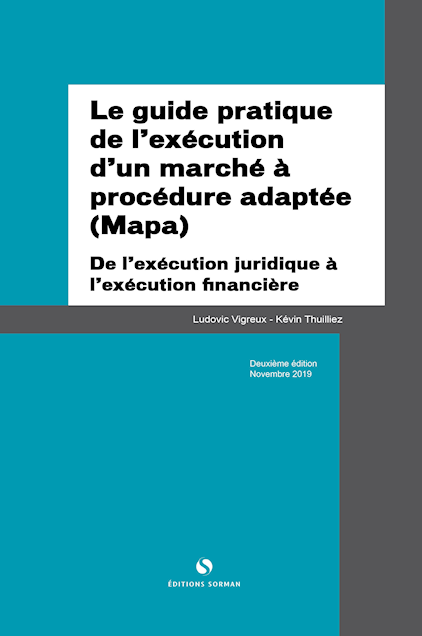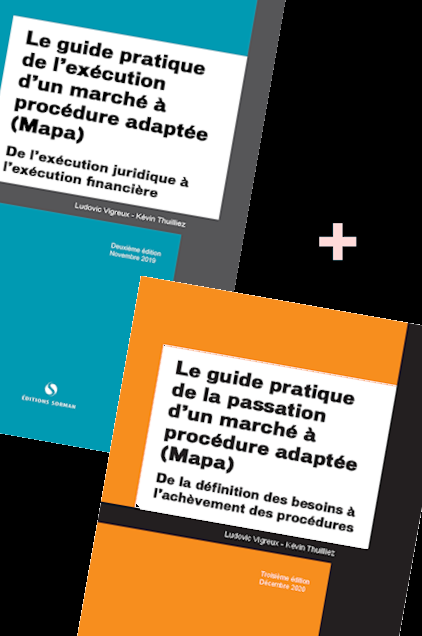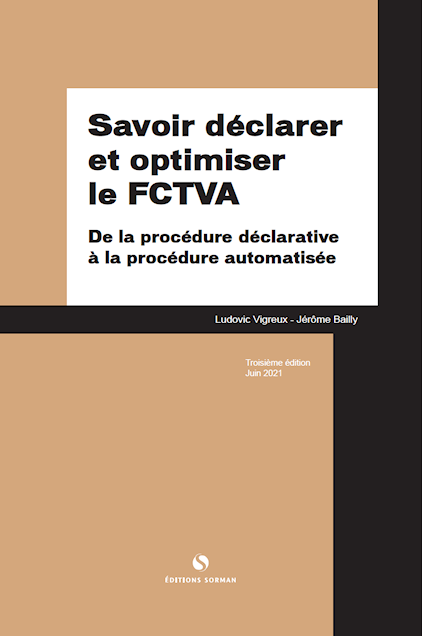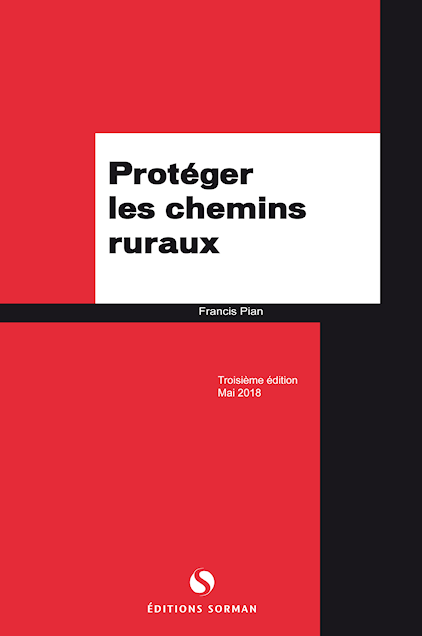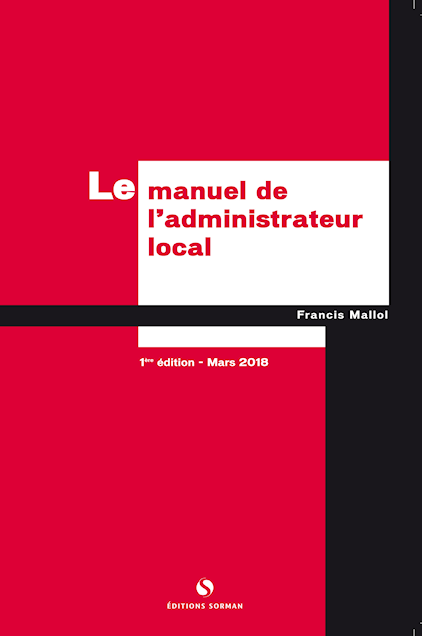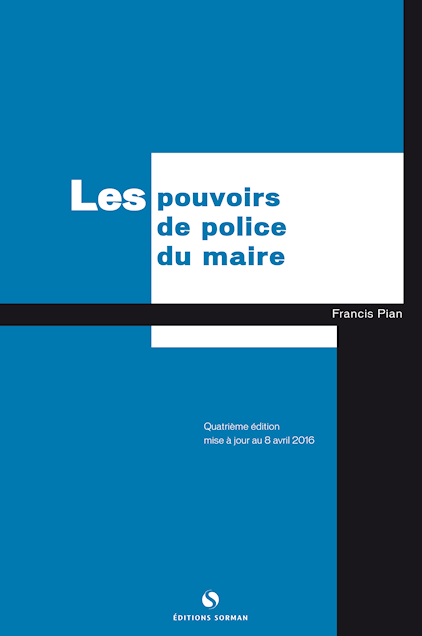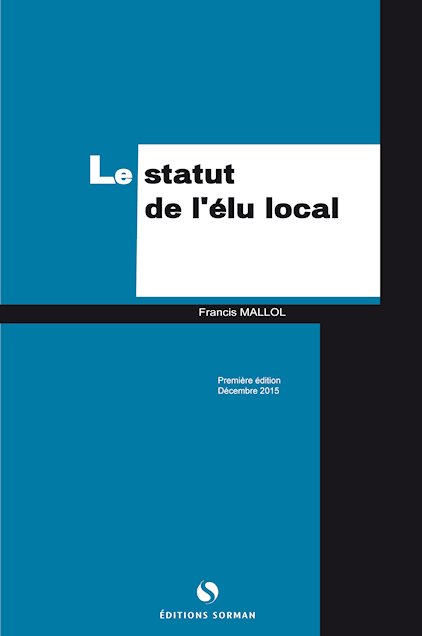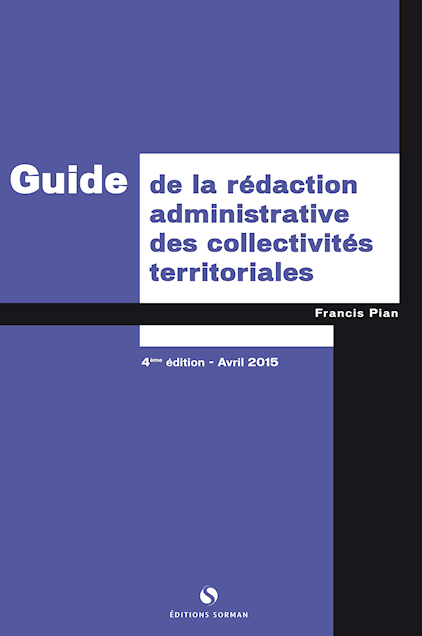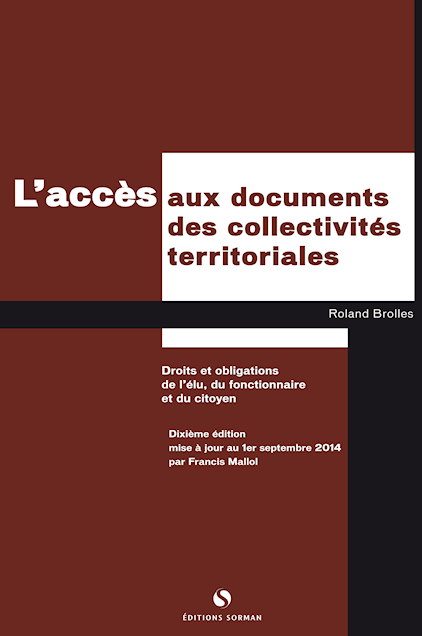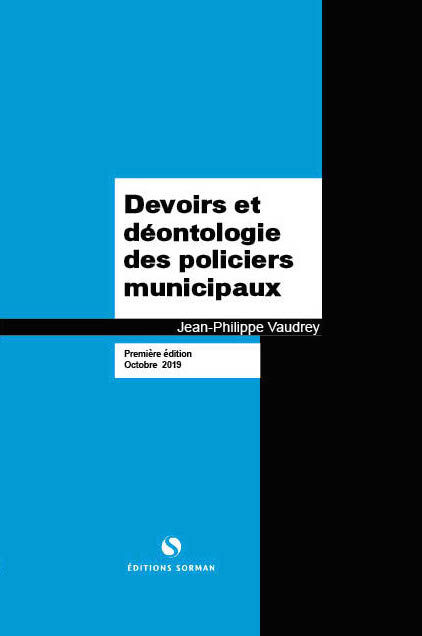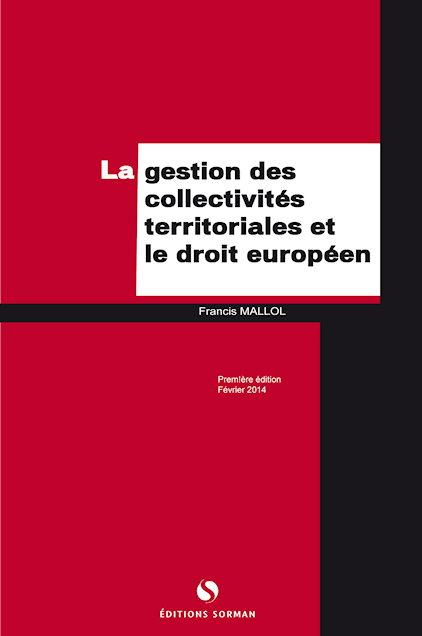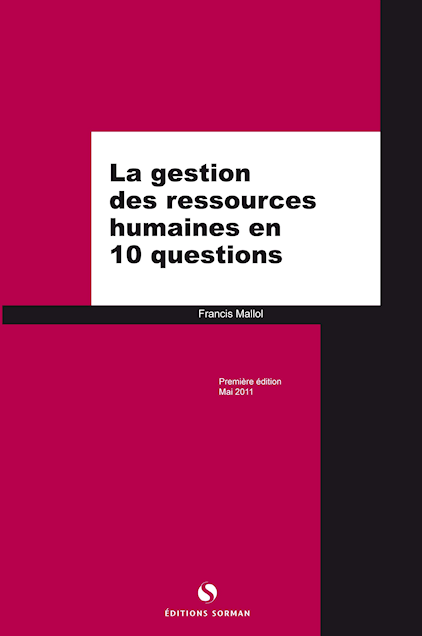Quelle est la situation des personnels suite à la dissolution d’une régie autonome administrative ?
Devant les difficultés financières de la régie et la perte des subventions de l’État et de la région, la commune décide, par une délibération du 28 juin 2016, d’en recentrer le périmètre sur une salle de spectacle et de mettre fin à l’exploitation le 1er décembre au plus tard. La décision entraîne la suppression de 2 emplois permanents d’agents en CDI d’administrateur en charge du suivi administratif et comptable et de directeur de la régie. Cette suppression, objet d’un avis favorable du comité social territorial du centre de gestion, est actée par le conseil d’administration de la régie le 28 juin 2016. Le 21 juillet, la présidente, qui a reçu les intéressés, les informe de leur licenciement au 1er décembre 2016.
Le tribunal annule, le 10 juillet 2018, la délibération du 23 mai décidant de dissoudre la régie sans fixer l’avenir des personnels, et les 2 licenciements, une décision que confirme la cour.
Que la régie possède ou non la personnalité morale, sa création et la cessation de son activité relèvent de délibérations du conseil municipal (articles R. 2221–1 et 16 du code).
En pratique, elle fixe la date de fin des opérations et arrête les comptes à cette même date. L’actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes de la commune, le maire étant chargé de liquider la régie mais pouvant désigner un liquidateur dont il fixe les pouvoirs. Ce dernier a la qualité d’ordonnateur accrédité auprès du comptable et prépare le compte administratif de l’exercice qu’il adresse au préfet, pour arrêt des comptes. Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable, annexée à celle de la commune. Au terme des opérations, elle corrige les résultats de la reprise des résultats de la régie par une délibération budgétaire.
L’obligation de statuer sur le sort des agents
Néanmoins, lorsqu’il s’agit d’une régie chargée de l’exploitation d’un service public administratif, la délibération fixe la situation des personnels et la soumet pour avis aux CAP (article R. 2221–62 du code).
En effet, les agents sont en principe soumis au statut de la fonction publique territoriale et, logiquement, en cas de disparition de l’établissement public employeur, l’organe délibérant de la personne publique de rattachement se prononce sur leur avenir.
Dans l’affaire, la délibération du 23 mai 2007 se limite à approuver les modifications du périmètre et des statuts de la régie à compter du 1er juin 2016, à désigner les membres de son nouveau conseil d’administration, acte le principe et la date de la fin de son exploitation, de sa mise en liquidation, des opérations de clôture des comptes, de reprise d’actif et de passif dans le budget de la commune. Seul l’exposé des motifs évoque, au plus tard au 1er décembre 2016, le licenciement des 2 agents. Pour le tribunal, comme pour la cour, cette seule mention ne répond pas aux exigences du code.
La commune oppose que le texte ne précise pas le degré de détail que la délibération doit atteindre concernant les modalités d’évolution de la situation des personnels et, sans doute, comme le reconnaît la rapporteure, le conseil municipal dispose-t-il d’une latitude, de sorte que la détermination de la situation des agents ne doit pas nécessairement figurer dans le dispositif de la délibération.
Cependant, le conseil municipal doit délibérer, expressément et en toute connaissance de cause, sur la situation des personnels, avec la disparition de la régie, et la délibération doit s’en faire l’écho, sinon dans son dispositif, du moins dans ses motifs ou le compte-rendu de séance.
Pour la rapporteure, cela suppose que le conseil municipal ait examiné la question en séance, au moment où la fin de l’exploitation de la régie est décidée et la date de fin des opérations arrêtées, cette décision devant déboucher sur une prise de position effective, claire et non équivoque sur le sort réservé aux agents, ou à tout au moins sur la marche à suivre et les options ouvertes.
Or, les intéressés ne sont pas nommés et leur licenciement est évoqué sans référence au code et aux obligations en découlant. Le conseil municipal en est informé comme d’un état de fait, n’a pas débattu de la solution arrêtée ni donc manifesté un quelconque accord sur la procédure envisagée.
Le Conseil d’État fait sienne cette analyse, rappelant que si le code n’impose pas de formalisme particulier à la rédaction de la délibération, elle doit comporter, dans ses motifs ou son dispositif, des éléments permettant d’établir que le conseil municipal a effectivement déterminé, à la date à laquelle les opérations de la régie prennent fin, la situation des personnels. Les concernant, il doit se prononcer sur la procédure envisagée et les issues possibles de cette dernière.
Dans l’affaire, il confirme la sanction de l’absence de prise de position effective sur le licenciement des 2 agents.
La nécessaire recherche d’un reclassement
S’y ajoute la question de l’obligation de reclassement des agents de la régie.
Ces dispositions ne font que reprendre un principe général, initié par le droit à reclassement des fonctionnaires définitivement inaptes physiquement à leur emploi (CE n° 227868 CCI de Meurthe-et-Moselle du 2 octobre 2002), étendu aux contractuels (CE n° 276863 ANPE du 26 février 2007). Ce principe général s’applique également si l’employeur entend remplacer un contractuel par un fonctionnaire (CE n° 365139 Mme A du 25 septembre 2013) ou s’il supprime son emploi dans le cadre d’une réorganisation du service (CE n° 366369 ministre de l’Éducation nationale du 18 décembre 2013).
A chaque fois, le juge a imposé au recruteur de tirer toutes les conséquences du choix de se séparer d’un collaborateur, l’astreignant à rechercher un emploi vacant équivalent avant le licenciement de l’agent. Strictement parlant et concernant une régie, l’obligation de reclassement cesse avec sa disparition, les régies avec la personnalité morale constituant juridiquement des personnes publiques distinctes de leur collectivité de rattachement.
L’obligation de reclassement pèse sur la commune
Mais, comme le rappelle la rapporteure publique, suivre ce raisonnement prive le droit au reclassement de contenu en cas de dissolution d’une régie, et n’apparaît pas insurmontable dans cette situation particulière.
En effet, les régies personnalisées ont des liens très étroits avec leur collectivité de rattachement, et si elle dispose d’une autorité propre, une interdépendance subsiste. C’est en effet le conseil municipal qui fixe ses statuts (article R. 2221–1 du CGCT), désigne, sur proposition du maire, les membres de son conseil d’administration et met fin à leurs fonctions (article R. 2221–5 du code). De surcroît, la commune a une grande liberté pour créer et supprimer une régie.
A l’origine de sa création et de la cessation de son exploitation, il paraît logique qu’elle en supporte les conséquences vis-à-vis des agents, notamment en matière de reclassement. C’est d’ailleurs dans la logique de l’obligation faite au conseil municipal de fixer la situation des personnels en cas de cessation et au maire de procéder à la liquidation.
S’agissant de l’autorité sur qui pèse l’obligation de reclassement, tant que la régie existe, y compris pour la période entre la décision de fin d’exploitation et de fin effective des opérations, le président du conseil d’administration conserve son pouvoir, ce qui peut, comme dans l’affaire, le conduire à licencier des salariés. C’est donc lui qui doit inviter l’agent à solliciter par écrit son reclassement.
En revanche, la régie ne pouvant assumer son obligation de reclassement du fait de sa dissolution, les offres ne pourront concerner que des emplois des services relevant de la collectivité de rattachement, donc de la commune.
En pratique, c’est finalement au maire qu’il appartiendra de chercher à reclasser l’agent au sein des services relevant de son autorité, sans qu’il s’agisse pour la rapporteure d’une obligation de reprise du personnel, qui ne relève d’aucun texte. Ce reclassement reste donc une obligation de moyens.
À son tour, le Conseil d’État confirme qu’il appartient au président du conseil d’administration de la régie, lorsqu’il notifie à l’agent la décision de le licencier pour suppression de son emploi par le jeu de la décision des autorités locales de renoncer à l’exploration de la régie, de l’inviter à présenter une demande écrite de reclassement. Saisie de cette demande, l’autorité territoriale ayant renoncé à l’exploitation doit chercher à reclasser l’agent au sein de ses services en lui proposant un emploi équivalent ou, à défaut, et si l’agent le demande, tout autre emploi.
Faute d’avoir bénéficié d’une telle procédure, le licenciement des 2 cadres est irrégulier.
CE 450115 M. D du 14 décembre 2022 et concl.
Pierre-Yves Blanchard le 23 mai 2023 - n°1814 de La Lettre de l'Employeur Territorial
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline