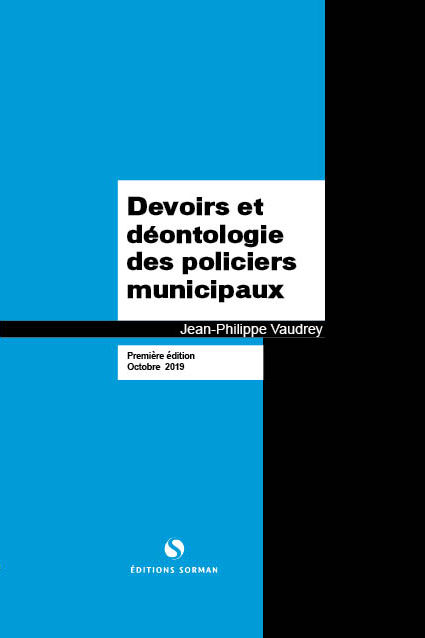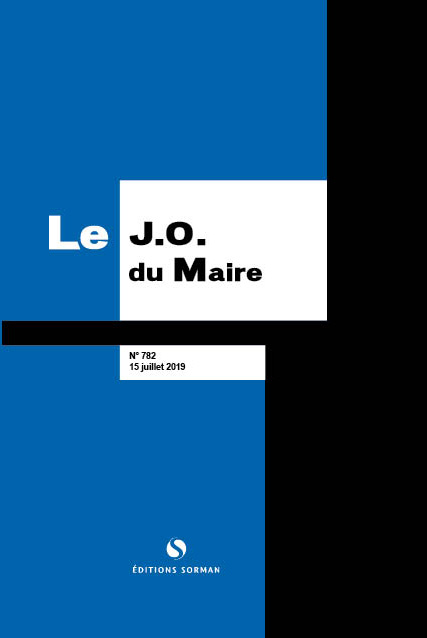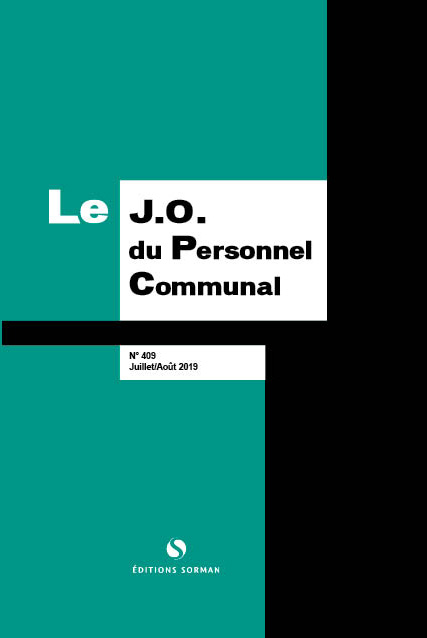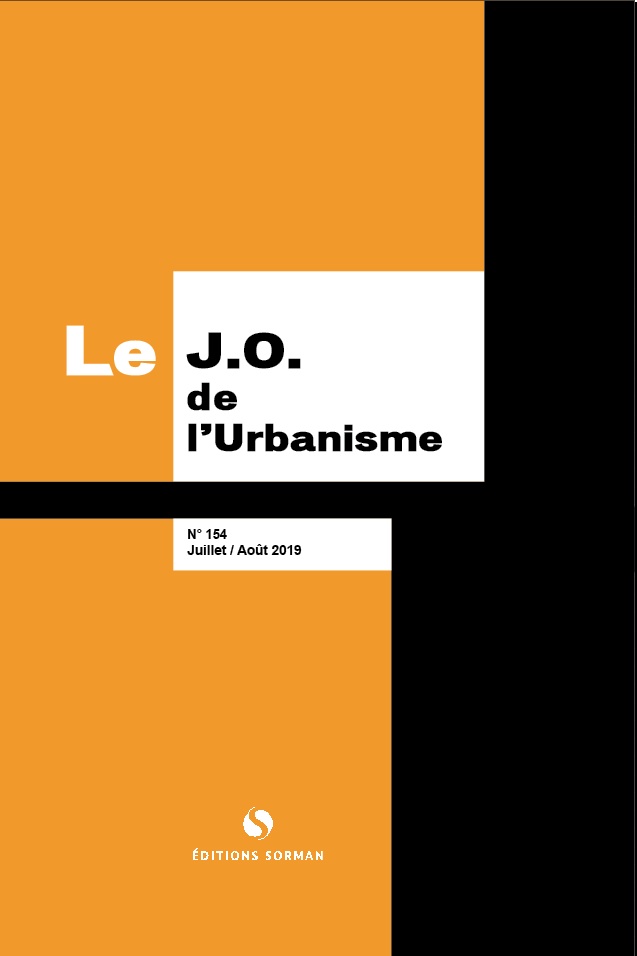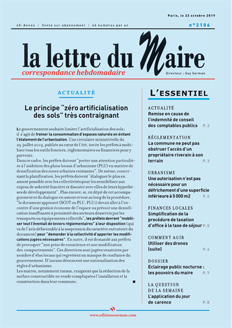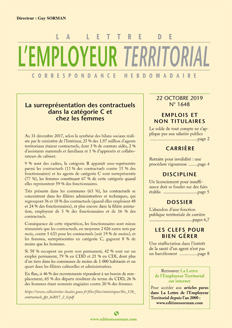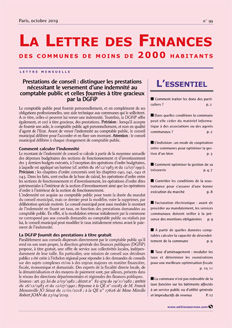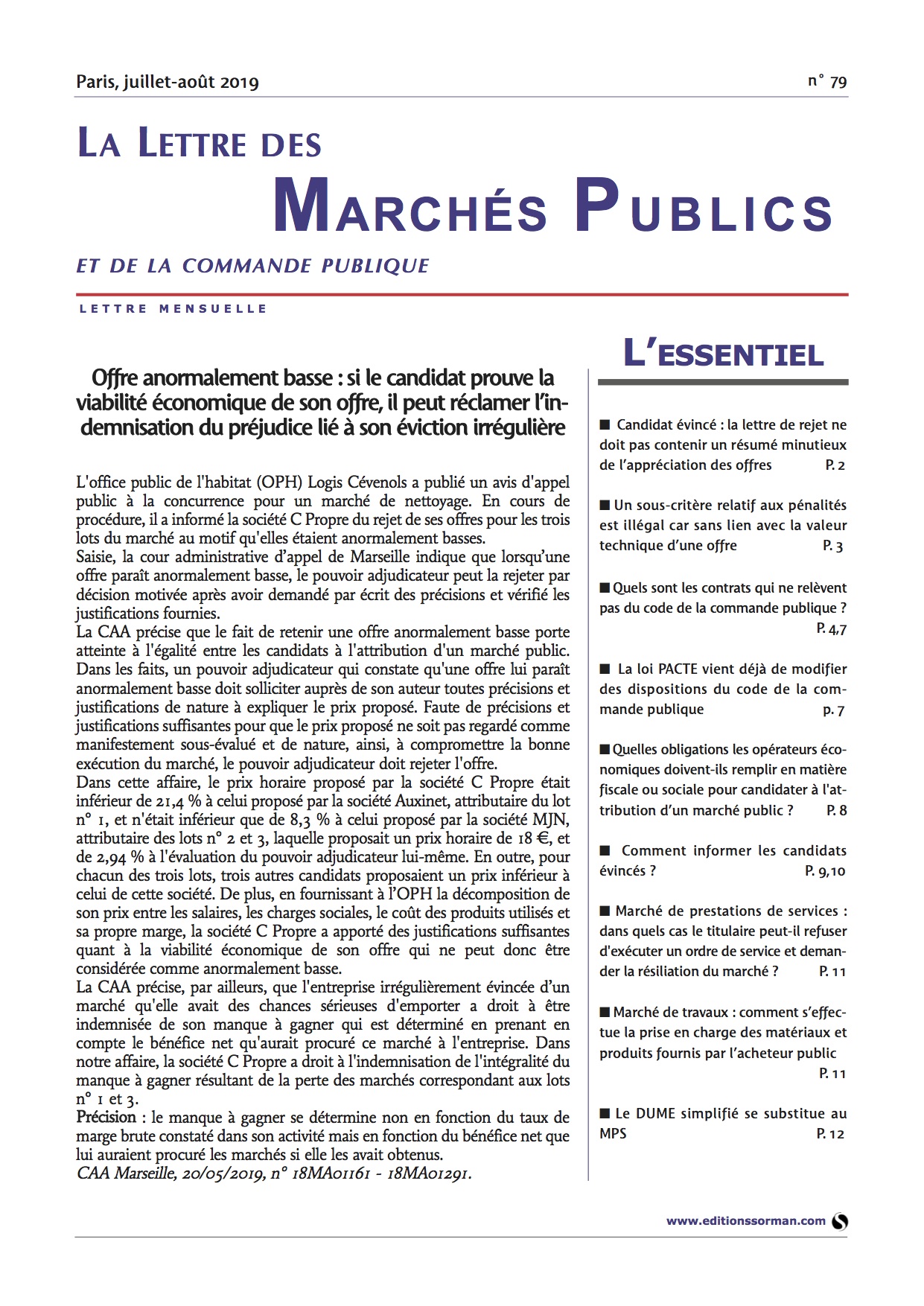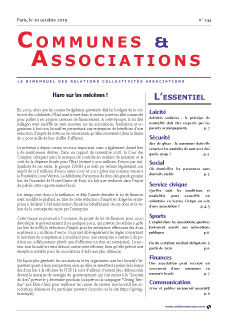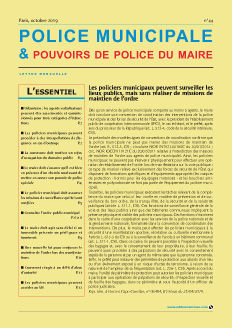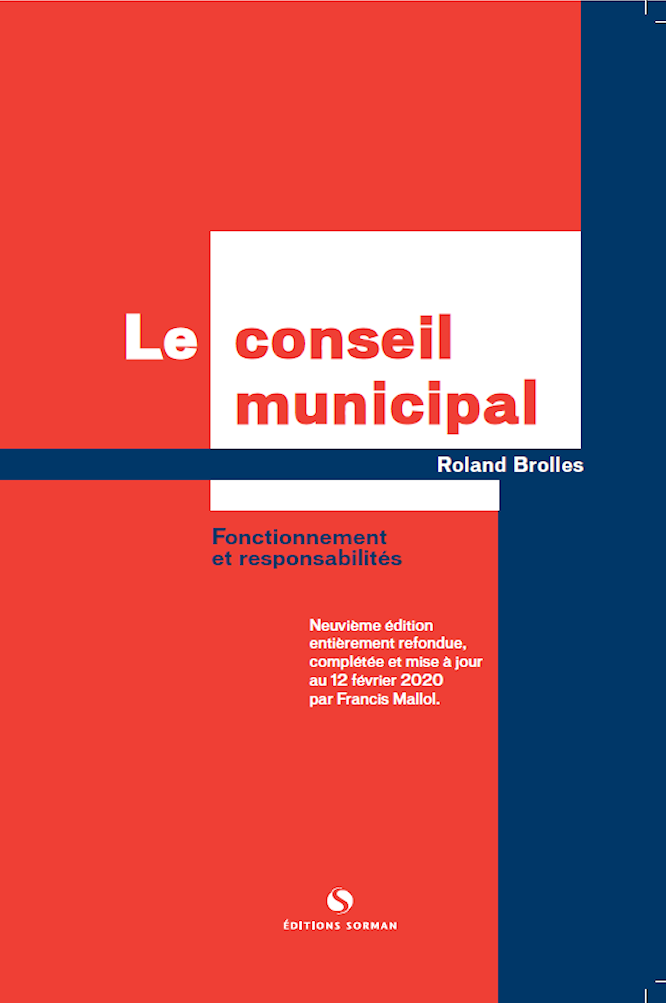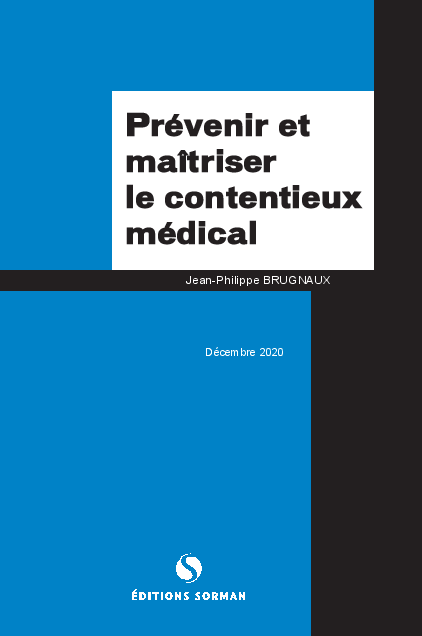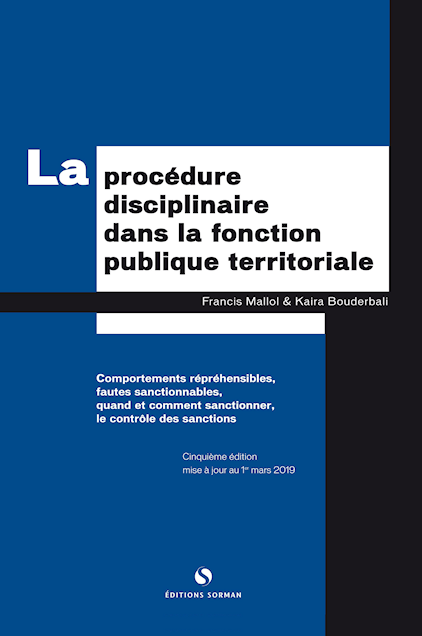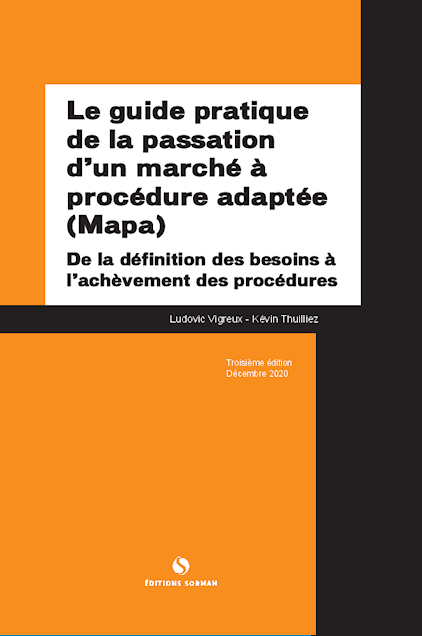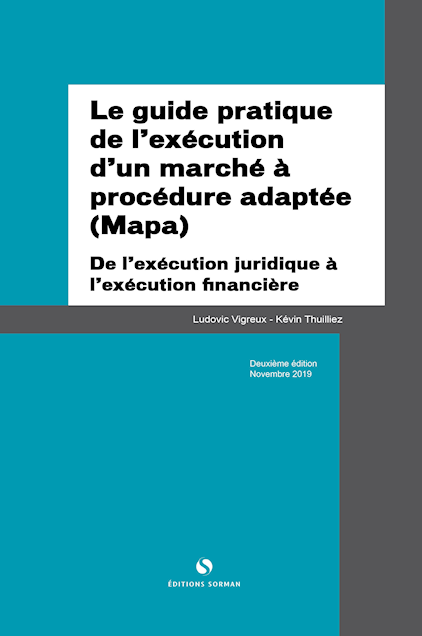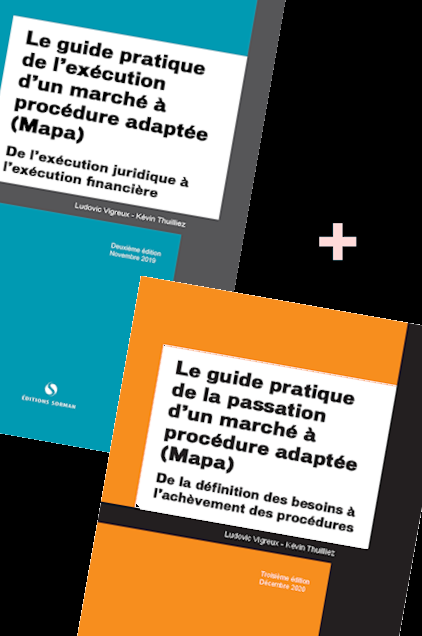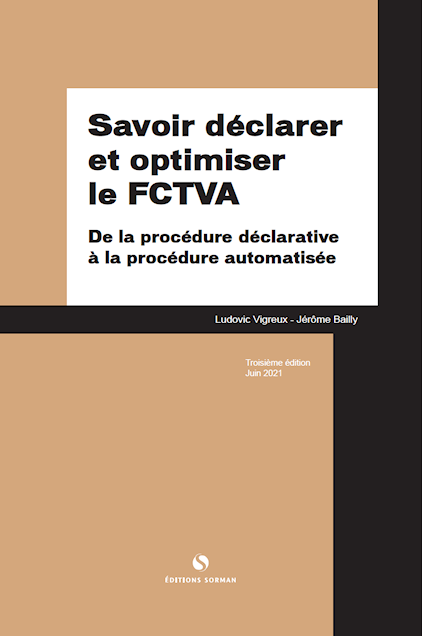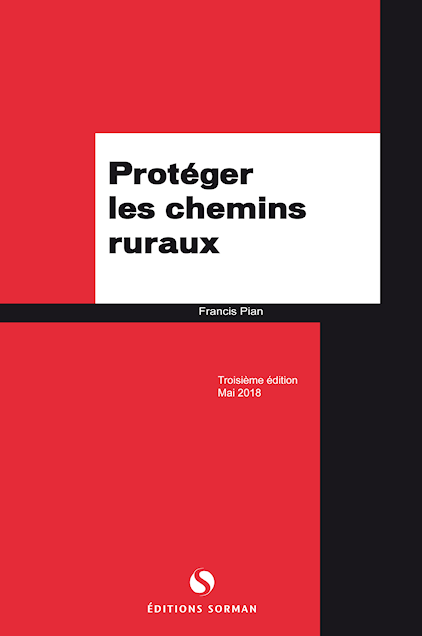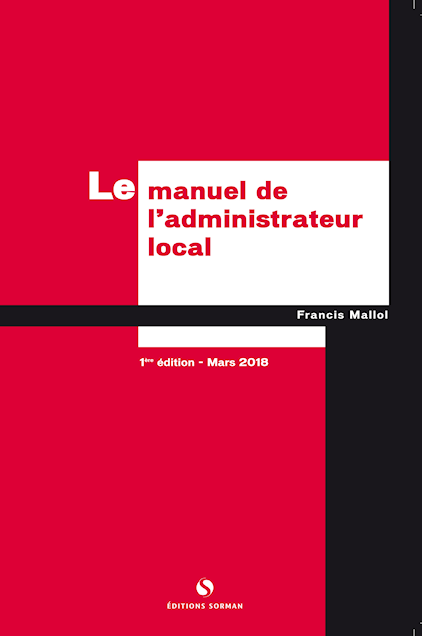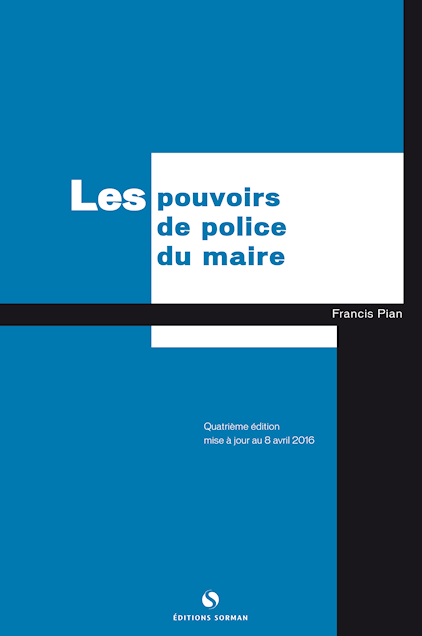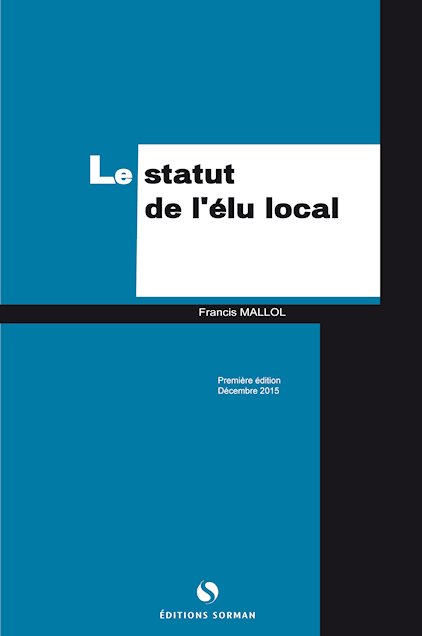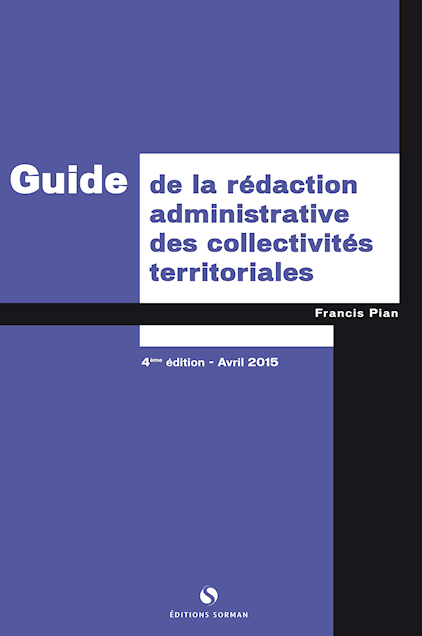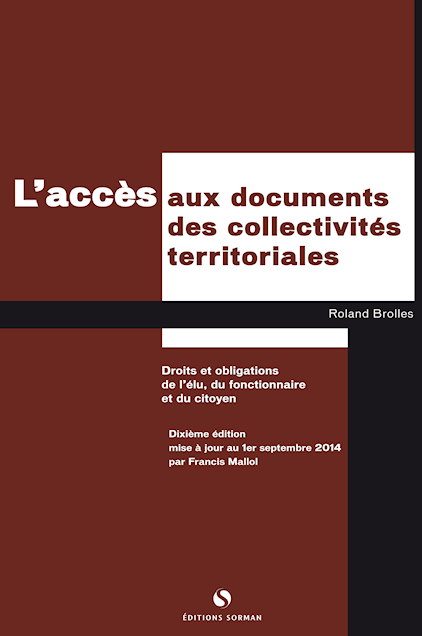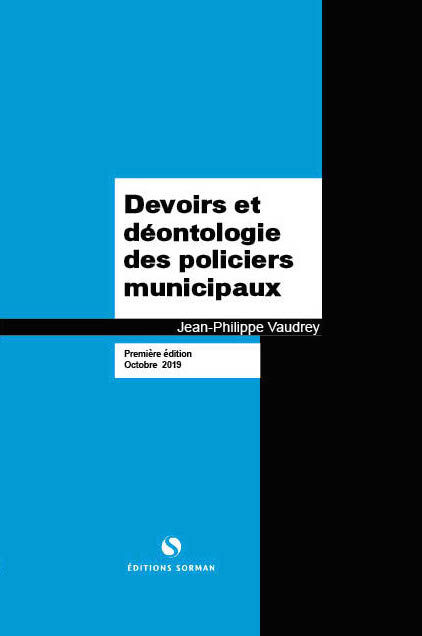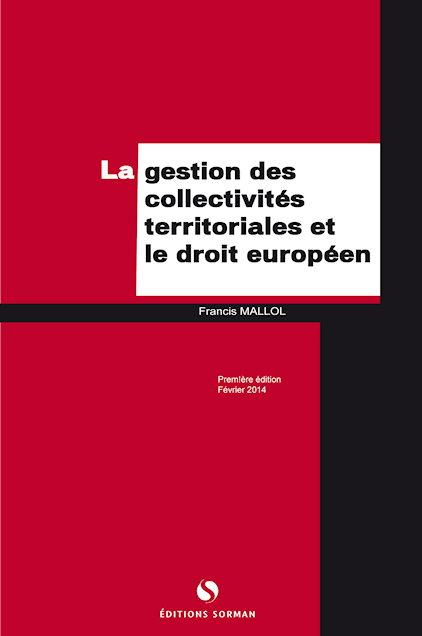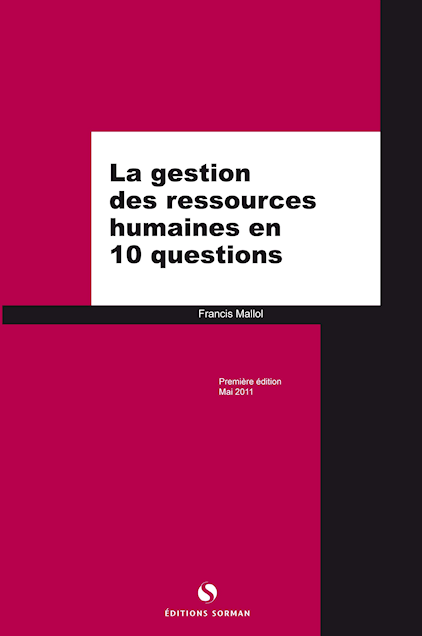Des poursuites pénales maintiennent la suspension
Il doit définitivement régler la situation de l’intéressé dans un délai de 4 mois et, à défaut, le rétablir dans ses fonctions s’il ne fait pas l’objet de poursuites pénales.
Dans le cas contraire, il peut prolonger la suspension et appliquer une retenue sur traitement limitée à la moitié de sa rémunération (traitement et indemnité de résidence, hors supplément familial de traitement).
En avril 2016, la loi a renforcé les droits du fonctionnaire, puisqu’il est rétabli dans ses fonctions au terme des 4 mois si les mesures de l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle. S’il ne retrouve pas son emploi, l’employeur peut l’affecter, provisoirement et sous réserve de l’intérêt du service, sur un poste compatible avec un éventuel contrôle judiciaire, et si nécessaire et provisoirement, dans le cadre d’un détachement d’office.
En tout état de cause, l’agent est rétabli dans ses fonctions en cas de non-lieu, de relaxe, d’acquittement ou de mise hors de cause.
Le maintien des poursuites pénales par le jeu de l’appel
Cette obligation supposant que la décision juridictionnelle présente un caractère définitif, l’appel du parquet contre le jugement du tribunal correctionnel maintient les poursuites pénales engagées.
Pour le Conseil d’État, un fonctionnaire doit être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales « lorsque l’action publique pour l’application des peines a été mise en mouvement contre lui », comme l’ouverture d’une information judiciaire (CE n° 74235 M. X du 19 novembre 1993) ou le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction (CE n° 239436 La Poste du 3 mai 2002).
Plus généralement, les poursuites pénales recouvrent l’ensemble des actes du ministère public ou de la partie lésée exerçant l’action publique pour renvoyer l’auteur de l’infraction devant une juridiction de jugement et obtenir sa condamnation.
Une décision de relaxe ne met donc pas fin à l’action publique tant qu’elle n’a pas acquis un caractère définitif et irrévocable, et l’appel du ministère public maintient les poursuites pénales. C’est ensuite à l’employeur de vérifier si l’intérêt du service requiert le rétablissement de l’agent dans ses fonctions.
En cas de non rétablissement, l’employeur motivera sa décision compte tenu des possibilités de réaffectation.
En tout état de cause, l’intervention d’un arrêt confirmant un jugement de relaxe ne rendra pas illégale, ni donc fautive, la mesure de suspension.
Rappel : son illégalité est susceptible d’engager la responsabilité de l’employeur (CE n° 93480 Dame X du 24 juin 1977), principalement parce qu’elle suppose que les faits présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité à la date de la suspension (CE n° 363202 M. A du 10 décembre 2014). Dans une telle hypothèse, l’agent peut obtenir réparation de son préjudice notamment moral (TA Lyon n° 0202492 du 14 octobre 2004).
Note DAJ A2 n° 2016-0053 du 16 novembre 2016.
Pierre-Yves Blanchard le 26 septembre 2017 - n°1552 de La Lettre de l'Employeur Territorial
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline